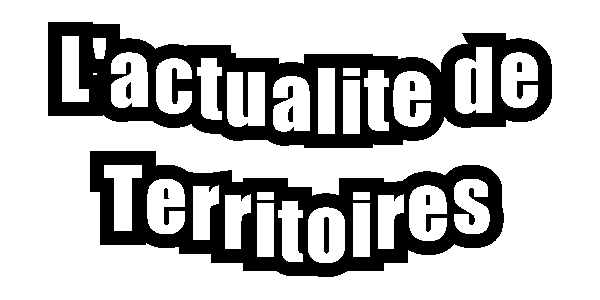| 📅 | Date limite de candidature : 18 octobre 2024 |
| 📍 | Siège social des Fermes de Figeac à Lacapelle-Marival |
Les haies comme objet de conception et de dialogue du projet local territorial. Une recherche-action en Ségala Limargue pour engager la transition agri-territoriale
Offre de thèse en géographie-aménagement (démarrage prévu premier semestre 2025)
Contexte de la recherche doctorale
Cette offre de bourse de thèse vise à accompagner le développement de collaborations largement engagées entre AgroParisTech et la coopérative agricole et de territoire des Fermes de Figeac depuis plusieurs années. Fort de plusieurs projets de recherche-action déjà réalisés (Réacteurs, Herbalogue), Fermes de Figeac et AgroParisTech sont également partenaires d’un consortium territorial réunissant l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (AEAG), le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, les Syndicats Mixtes du bassin du Célé-Lot Médian et de la Dordogne Moyenne et de la Cère Aval, l’EPLEFPA du Lot Animapole et la Chambre d’Agriculture du Lot. Ce consortium créé dans le cadre d’un projet intitulé « fermes en transition » déposé à l’AMI Démonstrateurs Territoriaux en 20231 vise à construire les conditions d’un laboratoire vivant au service des transitions agricole dans le Ségala Limargue lotois. Le sujet de thèse proposé s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de thèse CIFRE financé par l’AEAG mais le.la candidat. e retenu. e sera employé. e par les Fermes de Figeac à Lacapelle-Marival (Lot). Il. Elle sera rattaché.e scientifiquement à l’UMR Territoires de Clermont-Ferrand et aura ainsi accès aux dynamiques de recherche en cours sur cette question de la transition agricole et territoriale portée dans le cadre de deux groupes thématiques : « Agricultures et sociétés en transition » et « dynamiques et transitions des territoires ». La thèse sera rattachée à l’école doctorale École Doctorale LLSHS dès que l’ANRT aura validé le dossier qu’il conviendra de déposer avec le.la candidat.e sélectionné.e.
Sujet
Les haies ont constitué un élément majeur des politiques publiques agricoles en 2023. Appel national pour les haies lancé par l’AFAC-Agroforesterie en février, présentation du rapport du CGAAER « La haie levier de la planification écologique » en mai, annonce du Pacte en faveur de la haie présenté par le Ministre de l’Agriculture le 29 septembre, le sujet a occupé largement l’actualité. Cependant, les haies sont toujours traitées de façon ambiguë. Arrachées dans le cadre de recompositions foncières agricoles, maltraitées lors d’interventions de gestion diminuant leurs fonctions écologiques, écosystémiques, paysagères…, leur gestion, abordée à la seule échelle individuelle de la conduite des exploitations, suscite encore largement le désintérêt voire le rejet de bon nombre d’agriculteurs. Chiffres à la clé, le linéaire de haies a diminué de 50 % depuis 1950 dans le bocage français. La tendance s’est même accélérée entre 2017 et 2021 où 23500 km de haies disparaissent en moyenne tous les ans. Pourtant, toutes les études, rapports, expertises démontrent les services écosystémiques rendus par les haies dans un contexte de changement climatique ou leur rôle pourrait encore s’accentuer, notamment dans des dimensions liées aux tensions sur la ressource en eau, en qualité comme en quantité, et à de nouvelles fonctions nourricières liées par exemple à la végétalisation de nos assiettes. Les haies permettent de questionner l’écologie politique de nos territoires tout autant que notre rapport culturel aux paysages, à nos espaces vécus, à l’aménagement et au premier chef, à l’agriculture. Préserver, replanter, entretenir dans la durée des haies « multifonctionnelles » concerne de multiples acteurs, au premier rang desquels les propriétaires, les exploitants agricoles et les acteurs de l’agroforesterie, mais aussi les pouvoirs publics, les associations, les filières économiques, les habitants des territoires, etc. Plus généralement, par sa symbolique, la haie est l’affaire de tous. Tous ces éléments concourent à réfléchir à partir des haies à l’accompagnement des transitions dans les territoires. L’heure est donc à remobiliser la haie comme un activateur de dialogue en faveur de projets agricoles qui intègrent mieux cet objet dans une dimension multi-échelle et multifonctionnelle de l’exploitation agricole au territoire.
Pour autant, faire des haies un projet réellement fédérateur à l’ensemble des acteurs n’ira pas de soi. Tout le monde ne voit pas la haie de la même façon. Il ne s’agit pas simplement d’une question de label mais d’accords entre des acteurs multiples et divers, qui sont indispensables à la création d’un réseau de haies durables qui entend définir au premier chef ce que pourrait être une haie durable dans un territoire agricole. Dans un cadre de responsabilité politique clair, il est indispensable de coconstruire localement des projets autour des haies et des bocages pour activer la capacité des êtres humains à améliorer les qualités des territoires.
Le sujet étudié touche ici à une géographie de l’action qui interroge la construction de nouveaux modèles agri-territoriaux dans lesquels la haie trouve une place économiquement viable individuellement (pour l’agriculteur) et géographiquement repensée collectivement (pour la société locale). Elle met en exergue la nécessité de construire un cadre de coopération nouveau entre acteurs agricoles et acteurs territoriaux (élus, Etat, consulaires, associations…) pour faire de la haie un activateur de bien commun territorial.
Objectifs visés
La recherche vise à déplacer le regard sur la place des haies au sein d’un territoire, afin de ne plus regarder uniquement l’élément comme un simple linéaire, mais de l’intégrer à un dialogue constant et étroit avec les espaces et les êtres qui l’entourent. En quoi les haies participent-elles des nouvelles conceptions paysagères auprès des collectivités, des habitants ? En quoi traduisent-elles ou non un attachement des populations ou du monde agricole à une certaine image des espaces ruraux, souvent en référence à des pratiques agricoles passées, parfois comme un outil de réflexion pour répondre aux enjeux du changement climatique ? Quelles conceptions les agriculteurs et les autres habitants des territoires ont-ils d’une « haie en bonne santé » (du « label haies » à « la belle haie », de la « haie utile ou inutile » ?) ? En quoi, derrière le statut accordé aux haies, s’interroge l’enjeu de valoriser des espaces multifonctionnels dépassant leur image de « limite » pour jouer un rôle d’interface ? Au regard des aléas climatique, quelle reconnaissance ont les agriculteurs et les autres habitants de la haie comme outil d’adaptation individuelle et collective ? En quoi « déplacer le regard sur la place des haies au sein d’un territoire » plus que de permettre de réinsérer des haies dans les parcellaires agricoles peut contribuer à réinsérer les haies dans les projets des agriculteurs ? En quoi « déplacer le regard sur la place des haies au sein d’un territoire » peut contribuer à faire émerger les conditions et les moyens à réunir pour faire de la gestion durable des haies dans le Ségala lotois un projet d’intérêt commun aux agriculteurs et aux autres acteurs de la société ?
Derrière ces questions plusieurs objectifs seront principalement visés, mobilisant des approches méthodologiques de recherche-action :
- Le premier objectif sera de construire un état des lieux sur les représentations attachées aux haies chez différentes catégories d’acteurs dans le territoire étudié (ici les bassins-versants de la Bave, du Mamoul et de la Cère, affluents de la Dordogne lotoise). En recherchant dans l’état de l’art scientifique tous les travaux qui ont été produits sur le sujet en géographie, histoire, sociologie, ethnologie, agronomie…, il s’agira de dresser un panorama des verrous sociotechniques identifiés dans la littérature à l’œuvre dans la déconsidération persistante des haies chez certaines catégories d’acteurs et permettant de mieux comprendre les stéréotypes de caractérisation pour ces derniers.
- Le deuxième objectif sera de saisir les perceptions et les pratiques de gestion des haies dans le territoire du Ségala Limargue chez les éleveurs, afin de mieux identifier ce qui pourrait permettre une pratique de gestion plus durable des haies dans le La place de la haie dans les systèmes agricoles actuels sera étudiée, son fonctionnement sera décrit de manière à identifier quels modèles agricoles actuels (élevage, polyculture élevage, …) intègrent ou maintiennent celle-ci et pour quelles raisons ? Cette phase fera l’objet d’enquêtes à dire d’acteurs dans les exploitations agricoles situées sur les trois affluents concernés par cette recherche. Ces systèmes seront analysés finement pour identifier des pratiques qui pourraient être source d’inspiration pour de futurs modèles d’élevage, d’aménagement du territoire, avec le souci de créer des paysages de qualité. Des entretiens avec les agriculteurs permettront également de comprendre les points forts et difficultés de l’intégration des haies dans les systèmes agricoles, utilisant ici un travail cartographique de recensement des haies combinant des données quantitatives et qualitatives. Une projection de l’agriculture sur le territoire dans le futur sera abordée pour identifier les systèmes envisageables à l’avenir sur le territoire et la place que la haie peut prendre dans ces systèmes.
- Le troisième objectif sera de confronter les enseignements issus de la phase bibliographique avec ceux issus de la mobilisation de l’expertise des acteurs en situation dans le ségalas lotois dans la perspective d’une cogestion plus durable des haies. Il s’agira ici en s’inspirant de démarches de gestion et de gouvernance mises en œuvre dans d’autres territoires de construire des outils de recherche participante qui offre une gouvernance renouvelée des haies entre acteurs agricoles et non agricoles, entre citoyens, collectifs, associations, mais aussi acteurs de l’entreprise privée. Il s’agira de mieux caractériser les liens qui pourraient être activés pour inventer une gestion partagée de la haie considérée comme un bien commun territorial.
- Le quatrième objectif visera à penser les nouveaux modèles territoriaux de la haie du 21e siècle. Il s’agira en lien avec les acteurs territoriaux du Ségala Limargue lotois d’impulser les démarches participantes et créatrices qui réinterrogent la place et les fonctions des haies dans le territoire pour appréhender notamment la haie comme un outil d’appui à l’adaptation des effets du changement climatique et la régulation des risques avec notamment dans la gestion de l’eau : inondation, sécheresse, maintien de la biodiversité, des zones humides, cycle hydrologique et plus particulièrement de la qualité de l’eau…. Un déplacement par des démarches mêlant approches d’animation par le paysage et l’art sera privilégiée afin de susciter des régimes d’engagements nouveaux en faveur des haies dans le territoire.
- Un objectif opérationnel complétera cette thèse CIFRE en recherchant les leviers et les freins d’une utilisation et valorisation de la haie dans l’écosystème de l’exploitation agricole, qu’ils soient économiques (filières locales ou plus-values environnementales) ou fonctionnels tout en préservant la ressource et ses actions sur l’eau et la biodiversité. La thèse s’inscrira dans la politique de la coopérative agricole des Fermes de Figeac visant à construire une stratégie de transition des fermes du territoire. L’enjeu des haies sera donc positionné au sein du service R&D de la coopérative avec l’ambition de traduire opérationnellement les outils et connaissances de la thèse dans l’action.
Le terrain d’étude
Le terrain d’étude se situe à l’extrême nord-est du département du Lot en région Occitanie, dans la petite région agricole du Ségala-Limargue. Trois bassins-versants affluents de la Dordogne délimitent le périmètre d’étude : celui de la Bave, du Mamoul et de la Cère. Les trois cours d’eau sont sur le territoire de la coopérative Fermes de Figeac ayant un nombre important d’exploitants agricoles adhérents sur le secteur. Ces bassins-versants font l’objet d’un contrat de progrès territorial géré conjointement par le Syndicat Mixte Dordogne moyenne – Cère aval et l’AEAG.
Ce travail doctoral s’insère dans ce document stratégique sous l’action « diagnostic bocager sur les masses d’eau pilotes » visant à réaliser un inventaire bocager associé à un diagnostic fonctionnel des infrastructures concernées, au regard de la pression d’érosion mais aussi des bénéfices écosystémiques au profit des activités agricoles et des milieux aquatiques2.
Profil recherché
- Ingénieurs agronome ou paysagiste, master en géographie.
- Intérêt aux sciences participatives, à la médiation territoriale et aux animations multi-acteurs
- Intérêt pour le secteur agricole, les territoires ruraux et la problématique des transitions agroécologiques
- Intérêt pour les approches systémiques
- Connaissance de la conception, de la conduite et de l’analyse d’enquêtes
- Capacités de synthèse et de rédaction
- Aptitudes à travailler en équipe pluridisciplinaire, en contexte local multi-acteurs
Renseignements divers
- Salaire brut annuel : selon grille en vigueur du contrat doctoral
- Durée : 36 mois
- Type de contrat : Thèse CIFRE donnant lieu à un dépôt sur le site de l’ANRT
- Début du contrat estimé : premier semestre 2025
- Unité́ d’accueil : UMR Territoires
- Localisation : Siège social des Fermes de Figeac à Lacapelle-Marival
- Permis B et pratique autonome de la conduite obligatoires
Direction de thèse
- Laurent Lelli, Ingénieur de recherche, géographe/UMR Territoires laurent.lelli@agroparistech.fr
- Audrey Michaud, Maître de conférences HDR, zootechnicienne/ UMR Herbivores audrey.michaud@vetagro-sup.fr
- Guillaume Dhérissard, Directeur des Fermes de Figeac, Ingénieur agronome guillaume.dherissard@fermesdefigeac.coop
Candidature
Pour postuler, envoyez pour le 18/10/ 2024 aux membres de la direction de thèse votre dossier composé d’un CV et d’une note d’intention rédigée de 4 pages maximum esquissant votre proposition théorique et méthodologique pour appréhender ce sujet doctoral.
L’audition des candidats sélectionnés aura lieu avant le 15/11/ 2024 en présentiel obligatoirement (soit sur le campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand, soit dans les locaux des Fermes de Figeac à Lacapelle-Marival)