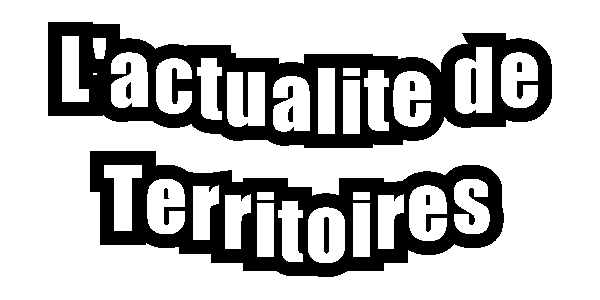| 🔎 | Colloque Transitions Territoriales - Recherche et action publique en contexte d'incertitudes et de tensions |
| 📅 | Du 24 au 26 novembre 2025 |
| 📍 | MSH Clermont-Ferrand et IADT |
Transitions territoriales –
Recherche et action publique en contexte d’incertitudes et de tensions
24-26 novembre 2025 – Clermont-Ferrand
https://transiter.sciencesconf.org/
Le terme de « transition » désigne le passage d’un état à un autre, voire le basculement d’un système entier d’un « régime d’équilibre dynamique » à un autre (Sanders, 2022 ; Boulanger, 2015). Malgré les moments difficiles que ce terme a connus, par exemple lors du constat de l’impasse des transition studies dans les années 1990 (Dufy, Thiriot, 2013 ; Rolland et al., 2017), il a eu un regain d’usage dans le débat public et dans la sphère scientifique dans les décennies suivantes (Coudroy de Lille et al., 2017). On parle ainsi par exemple de transitions agroécologiques, au pluriel, pour souligner à la fois le besoin d’adaptation des solutions aux socioécosystèmes localisés, mais aussi l’humilité nouvelle de la recherche agronomique dans le codesign de ces solutions. Le pluriel s’impose pour décrire la diversité des processus de transition écologique (Loudiyi et al., 2022). On parle également de « transition énergétique » pour désigner le passage d’un mode de production et de consommation d’énergies fossiles à un mode privilégiant les énergies renouvelables, même si l’application de cette notion à l’histoire énergétique fait l’objet de fortes critiques (Aykut et Evrard, 2017 ; Fressoz, 2024). On notera toutefois que cette déclinaison thématique ou sectorielle est assez peu attentive à la question du local. De même, l’engouement pour les sustainable transition studies laisse place au doute, en raison de sa « naïveté spatiale » (Hansen, Coenen 2015 ; Banos et al., 2023). On reproche aussi parfois à la « transition » les glissements qu’elle permet entre registre normatif et descriptif, même si cet alliage peut aussi permettre un positionnement à l’interface entre démarche scientifique et demande publique.
Depuis le début de la décennie 2020, la notion de « transition territoriale » se répand dans un contexte de forte demande d’accompagnement académique de la part de différents acteurs territoriaux. Alexis Gonin (2021) en donne une définition claire : « La transition territoriale est le changement systémique à l’échelle d’un territoire, qui modifie en profondeur les modes d’habiter, les systèmes productifs, et les relations au milieu d’un collectif d’acteurs engagés dans un projet commun ». Pour autant, le socle théorique n’est pas encore stable et robuste. S’agit-il d’un simple objet transactionnel entre recherche scientifique et sphères de l’action publique territoriale ? De l’instrument d’une requalification de l’ingénierie ? D’un mot-valise sans fondement scientifique ? Ou d’un front de recherche porteur, dans un monde marqué par les incertitudes ?
L’objectif de ce colloque est d’interroger, dans une perspective pluridisciplinaire, cette notion de « transition territoriale » – sa pertinence, ses utilisations et traductions, ses pistes de consolidation théorique ainsi que sa portée heuristique et transformatrice – dans un contexte de crises multiples, de fortes tensions sociopolitiques et géopolitiques et d’incertitudes sur le devenir des systèmes territoriaux. Comment penser, étudier, voire accompagner les transitions des territoires en contexte d’incertitudes et de tensions ?